J’avoue une (petite) escroquerie dans le titre, malgré tous mes efforts je n’ai, à mon grand regret, pas encore pu observer de danseuse de tango qui porte des bas nylon. L’activité s’y prêterait pourtant parfaitement, on y est friand de jambes galbées, soulignées par une jolie couture bien placée, dans des positions… Malheureusement, de nos jours, on ne voit plus guère que des collants. Résille, couture, les deux, mais désespérément collants. Il est un point sur lequel le tango ne déçoit pas : les chaussures des femmes sont magnifiques ! (et celles des hommes sont, aussi, munies de talons, ça évite les jalousies)
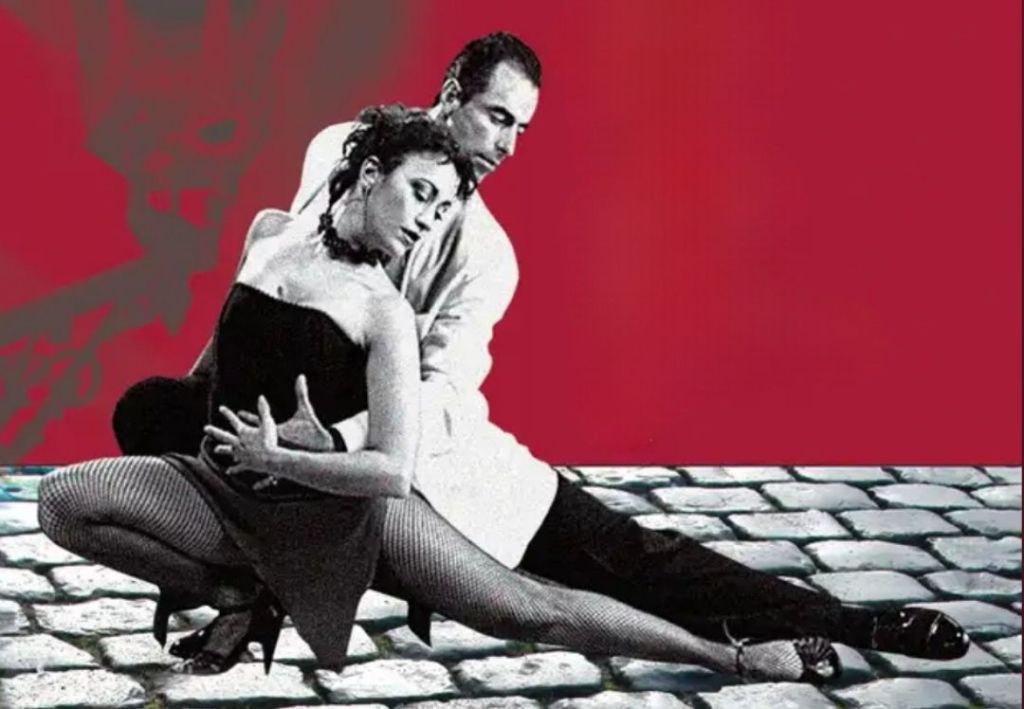
Pochette d’un album de tango
Petit historique sommaire : il se raconte que le tango est une danse qui est née à peu près en même temps que le XXe siècle, dans les maisons closes de l’Abasto, à Buenos Aires. En pratique ses origines sont plus floues que ça et renvoient à un joyeux mélange de danses et de rythme d’esclaves et de danses européennes – à cette époque l’Argentine attirait une importante immigration européenne, principalement italienne, espagnole et française.
Des maisons closes au monde, il y a un pas que le tango va faire en une vingtaine d’années – voici pour mémoire ce qu’en disait Gérard d’Houville dans le Figaro du 6 avril 1913 :
Le tango est à la mode ! Apprenons le tango ! Cela n’est pas si ridicule de suivre la mode et de l’écouter. Elle essaye de varier, sinon notre vie, du moins ses aspects… Ah ! oublier que tout nous fuit ! ne pas songer que chaque heure nous rapproche de la vieillesse et du néant ! C’est là un si vrai, un si profond besoin de la nature humaine que l’on invente même pour les morts, pour les pauvres morts qui s’ennuient, mes danses macabres, les rondes de squelettes, que mène le Temps avec sa faux, afin que les vivants agités pussent, au cimetière encore, songer à danser sans impiété. Sans profanation… Il faut danser par-delà les tombes… Dansons donc le tango !
D’ailleurs, l’émigration française va avoir une importance déterminante sur cette danse, dans la mesure où une des étoiles filantes du tango serait née à Toulouse. Je parle bien sûr de Carlos Gardel, qui fut l’inventeur du tango chanté, avant de devenir une star internationale. Il tourna dans une dizaine de films et interprétera bon nombre de chansons avant son décès accidentel, en 1935.
Le tango arrive à Paris en 1910, il est introduit dans les salons parisiens par Mistinguett, et par les fils de bonne famille argentine qui venaient faire leur apprentissage en Europe et profitaient de l’éloignement pour s’encanailler. La Grande Guerre le force à entrer dans la clandestinité, les bals étant interdits pendant cette période. C’est pour mieux en ressortir une fois la fin de la guerre actée et dominer les salons de danse en Europe jusqu’à la Crise au début des années 30. À ce moment, il se transforme, sa version septentrionale devient musette en France, et est codifiée strictement par les anglais qui en font à la fois une danse de salon et une danse de compétition, au rythme fixé à 120BPM. Pas plus. Pas moins. Pas de variation. C’est anglais, que diable !
Alors qu’il perd la faveur des foules dansantes en Europe, dans la région du Rio de la Plata le tango subit une véritable explosion. On ne compte plus les orchestres, un certain nombre de morceaux fondamentaux sont composés à cette époque par des chefs devenus légendaires dans ce petit monde. Gardel allait partir, mais c’est l’époque de Troilo, d’Arencio, de Pugliese pour n’en citer que quelques-uns, dont les morceaux animent encore aujourd’hui les milongas, au-moins en France et à Buenos Aires. Le style devient plus varié, les orchestres de tango se mettent à interpréter deux autres danses issues elles aussi de mélanges : la milonga (qui existait avant le tango), une marche assez vive et enlevée, et la valse qui est jouée par les orchestres de tango sur 3 temps.
Le tango traversera le XXe siècle dans ses forme européennes, la version du Rio de la Plata connaîtra une éclipse pendant les dictatures en Argentine, entre les années 50 et 80. Ça reste tout de même l’époque de quelques grands musiciens, le plus connu d’entre eux étant Astor Piazzolla, à qui on attribue un style plutôt destiné à être écouté dans une salle de concert que dansé : le « tango nuevo ».
Le retour en grâce s’est fait à partir du spectacle « Tango Argentin« , qui a rencontré un vif succès en 1985 à Paris. Celui-ci a relancé la mode de cette danse, dans sa version sud-américaine : une version très peu codifiée, sans véritable « pas de base », qui se danse toujours à 3 : le danseur qui guide, la danseuse qui suit le guidage, et la musique pour les gouverner tous. Musique qui ne se prive pas de varier son rythme, de faire des pauses, de repartir (et ferait s’étrangler les personnes qui ont codifiée la version de compétition), pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles.
Petit aparté : on appelle « milonga » indifféremment la danse dont j’ai parlé plus haut et le lieu où on danse le tango. Autre détail qui me semble important : on ne danse pas en milonga exactement comme en spectacle : en spectacle, on danse sur une chorégraphie qui se doit en général de présenter des passages spectaculaires. Ces passages sont travaillés entre la danseuse et le danseurs, qui savent tous les deux à quoi s’en tenir. En milonga, on enchaîne les pas et les passes sans avoir cette complicité, le danseur doit être parfaitement clair dans son guidage, la danseuse doit se laisser aller et suivre.
Les années 90 ont apporté une autre innovation musicale, qu’on a connu en France à travers le succès du groupe Gotan Project : le tango électro. Où l’introduction de samples et d’un rythme très « carré » dans un style qui s’en passait très bien. Tout n’est clairement pas à jeter dans ce style non plus. Cette version a une immense qualité : elle donne au danseur débutant une base stable et assez facile pour se lancer. Avant qu’il n’affronte des « vrais » morceaux, ceux issus de la période 1930-1950.
… et les bas dans tout ça ? J’ai prévenu au début, ils ne sont pas (assez) présents dans la version moderne de cette danse. Sauf… au cinéma, qui a parfaitement compris la puissance émotionnelle de cette danse ! Sans vouloir faire un panorama complet des films parlant de tango (voir les liens ci-dessous si le sujet vous intéresse vraiment), il y a deux films récents assez célèbres où on trouve une scène de tango qui laisse la part belle aux bas : le « Tango de Roxane » dans Moulin Rouge et le « Cell Block Tango » dans Chicago. Je ne mets qu’une vidéo du deuxième, je n’ai pas trouvé le premier dans une qualité correcte sur Youtube. Très cliché, mais ça n’en reste pas moins très agréable à regarder !
Informations complémentaires
Pour les personnes qui seraient intéressées par le tango au cinéma, j’ai trouvé sur la base de données des films sur Internet une liste de films sur le sujet. J’ai fait le lien avec la liste des films du Boss, sauf si j’en ai manqué les deux seuls qui sont présents dans les deux listes sont Moulin Rouge et Chicago.
Pour les personnes qui seraient intéressées par le tango tout court mais regrettent de ne pas trouver d’endroit où le danser, le site tango-argentin.fr est fait pour vous : il donne, pour toute la France, une liste de manifestations liées au tango – bals, milongas, concerts, spectacles, etc, en précisant aussi, pour les manifestations dansantes, si ça sera avec un DJ ou avec un orchestre, si une démonstration est prévue, etc.
Dans cet article, je parle de « tango de la Plata » et pas de « tango argentin ». Le fait est que le tango est revendiqué à égalité par 2 pays : l’Argentine et l’Uruguay, les deux ayant de très bons arguments. Ce n’est pas parce-que l’Argentine est le pays d’origine le plus connu qu’il faut oublier l’Uruguay, après-tout, la Cumparsita, qui est sans doute LE morceau le plus connu de tango et qui clôt toutes les milongas, a été composée à Montevideo en 1916 par un musicien uruguayen, Gerardo Matos Rodriguez, avant d’être reprise en Argentine.

Laisser un commentaire